Article paru initialement dans le Journal Le Monde
Collectif, Le Monde,
12 décembre 2018
Un collectif de chercheurs présente, dans une tribune au
« Monde », les premiers résultats d’une étude détaillée qui s’appuie
sur 166 questionnaires distribués sur des ronds-points et lors de
manifestations.
Une équipe de 70 universitaires mobilisée
Collectif d’universitaires, nous avons lancé, dès la fin du
mois de novembre, une enquête de terrain pour comprendre le mouvement des
« gilets jaunes ». Nous sommes allés les rencontrer dans différentes
régions de France, dans les manifestations et sur les ronds-points. Nous
livrons ici les premiers résultats sur les profils et les motivations qui apparaissent
derrière les « gilets jaunes ».
Le 21 octobre, Priscillia Ludosky crée une pétition en
ligne « Pour
une baisse des prix du carburant à la pompe ! ».
Rapidement et massivement diffusée sur les réseaux sociaux, relayée par les
médias, la
pétition atteint 200 000 signataires en quelques jours, et
plus de 1 million aujourd’hui.
Une journée d’action est prévue le 17 novembre, avec
pour mots d’ordre la baisse des taxes et du prix des carburants. Cette
mobilisation est préparée de manière décentralisée et autonome par des groupes
locaux et nationaux, qui s’organisent notamment sur la plate-forme Facebook. Le
17 novembre, ce sont plus de 280 000 personnes, vêtues d’un
gilet jaune, qui participent à cette mobilisation dans la France entière,
principalement à travers des actions de blocage des routes, au niveau des
ronds-points ou péages. A Paris, une manifestation a lieu sur les
Champs-Elysées et certains manifestants tentent de se rendre au palais de
l’Elysée, avant d’être bloqués par la police. Dans les jours qui suivent cette
journée de mobilisation, les blocages continuent et d’autres journées de
manifestations sont lancées pour les samedis suivants.
Au lendemain du 17 novembre, des chercheuses du Centre
Emile-Durkheim (Bordeaux) lancent un appel à participation auprès de la
communauté des chercheurs et chercheuses en science politique pour comprendre
le mouvement. Le collectif compte aujourd’hui près de 70 personnes, qui
sont des enseignants-chercheurs, des chercheurs au CNRS et à l’INRA, des
docteurs sans poste, des étudiantes et étudiants. Sociologues, politistes et
géographes travaillent ensemble sur la base du volontariat.
L’ampleur du mouvement et la rapidité avec laquelle il s’est
constitué, en dehors des organisations syndicales et des partis, tout comme ses
modes d’action et ses mots d’ordre interpellent. Qui sont les « gilets
jaunes » ? Que souhaitent-ils ? Assiste-t-on à un renouvellement
profond des modalités de la protestation et de la politique ? Faut-il y
voir un retour de formes traditionnelles de révoltes populaires ? Comment
un tel mouvement est-il susceptible d’évoluer dans le temps et comment
comprendre sa portée ?
166 questionnaires analysés
L’objectif de l’enquête « gilets jaunes » est de
récolter des données pour saisir sociologiquement ce mouvement. Il s’agit de
comprendre sa complexité, sa composition et son évolution, de recueillir les
revendications de ses participants et participantes et de mesurer la variété de
ses modalités d’organisation et de mobilisation. Des groupes de travail se sont
mis en place à partir de différentes méthodes : observation sur le
terrain, analyse lexicométrique des réseaux sociaux, questionnaires,
entretiens, cartographie. Parallèlement à ce questionnaire, une équipe de
géographes mène une enquête complémentaire en Normandie. Les données sont
toujours en cours de décryptage. Les premiers résultats présentés ici sont
basés spécifiquement sur l’analyse des questionnaires administrés dans les
manifestations, sur les ronds-points et aux péages.
Nous partons du terrain pour établir nos résultats. La
parole des personnes et leurs attentes sont au cœur de l’enquête, notre
objectif a été de les récolter et de les restituer le plus fidèlement possible.
Les données sont traitées selon des méthodologies croisées qui rendent compte du
mouvement d’une manière plus approfondie et complexe qu’un seul point de vue ne
permet de le faire.
L’équipe « questionnaires » se compose de
13 personnes basées à Bordeaux et sa région, Marseille, Caen et sa région,
Rennes, Montpellier, Grenoble et sa région. Pour cette enquête, nous avons
décidé de nous concentrer sur les personnes actives dans le mouvement, ayant
participé au moins à une manifestation ou un blocage, et avons pu analyser
jusqu’ici 166 questionnaires diffusés les 24 novembre et 1er décembre.
L’enquête est toujours en cours et se poursuivra dans les semaines qui
viennent. Nous avons choisi de mener des entretiens en face à face, démarche
qui permet de recueillir des témoignages plus riches, plus précis et plus longs
que la passation de questionnaires indirecte ou en ligne. Le
questionnaire compte en tout 28 questions, 5 d’entre elles sont ouvertes,
et nous avons en outre pris soin de noter les commentaires sur l’ensemble des
questions posées. Concernant les sujets abordés, 15 questions portent sur
les motivations des participants, les réformes souhaitées, les modes d’action
privilégiés et leur rapport au politique ; les 13 dernières portent sur le
profil sociodémographique des personnes mobilisées.
Les questionnaires ont été majoritairement administrés par
les enquêteurs. Le temps requis à recueillir les réponses varie d’une dizaine
de minutes à quarante minutes. L’administration de questionnaires en
manifestation est un exercice délicat en raison de la mobilité et, dans ce
contexte particulier, de l’incertitude sur le parcours du cortège et des
dispositifs de maintien de l’ordre. Cette recherche est réalisée sans fonds
spécifiques et n’a été rendue possible que par le travail de nombreuses et
nombreux collègues, étudiantes et étudiants volontaires.
Tribune
S’il n’y a pas de portrait type des manifestan–ts,
puisqu’une des caractéristiques du mouvement est sa diversité, les
« gilets jaunes « sont d’abord des personnes, hommes et femmes, qui
travaillent (ou, étant retraités, ont travaillé), âgées de 45 ans en moyenne,
appartenant aux classes populaires ou à la « petite » classe moyenne.
Les résultats, encore très provisoires, présentés ici
s’appuient sur l’analyse de 166 questionnaires distribués auprès
des participants aux actions sur les ronds-points et aux péages, ou lors des
manifestations ayant eu lieu les 24 et 1er décembre, par une
équipe d’une dizaine de chercheurs et d’étudiants. Le questionnaire a
été élaboré de manière à recueillir des informations détaillées et précises sur
les participants.
- Une surreprésentation des employés
et une sous-représentation des cadres
Certaines catégories apparaissent comme particulièrement
surreprésentées au sein des « gilets jaunes » qui nous ont répondu.
C’est le cas des employés, qui constituent 33 % des participants (soit
45 % des actifs présents, contre 27 % de la population active
française). Ils sont plus de deux fois plus nombreux que les ouvriers, qui
représentent 14 % des participants. Les artisans, commerçants et chefs
d’entreprise sont également particulièrement nombreux : 10,5 % des
participants (14 % des actifs présents, contre 6,5 % de la population
active française).

A l’inverse, les professions intermédiaires et les cadres
sont peu représentés : les premiers comptent pour 10 % des
participants (13 % des actifs présents, contre 26 % de la population
active française) ; les seconds sont à peine 5 % des participants
(7 % des actifs présents, contre 18 % de la population active
française) dans les cortèges et blocages qui ont eu lieu entre le
24 novembre et le 1er décembre. Un quart des participants
au mouvement des « gilets jaunes « appartiennent à la catégorie
« inactifs » ; pour la majeure partie, il s’agit de retraités.
- Des manifestants « d’âge
moyen »
Les « gilets jaunes » participant à l’enquête ont
en moyenne 45 ans, un peu plus que l’âge moyen de la population française,
qui s’élève à 41,4 ans. Les classes d’âge les plus mobilisées sont les 35-49
ans (27,2 %), puis les 50-64 ans (26,6 %) et les 25-34 ans. Les 18-24
ans représentent 6,2 % des participants ; les plus de 65 ans,
17,3 %.
- Un mouvement mixte
Les hommes (54 %) sont un peu plus nombreux que les
femmes (45 %). Cependant, la forte proportion de femmes, appartenant
souvent aux classes populaires, une catégorie sociale traditionnellement peu
mobilisée politiquement, est un fait notable. On y lit une propension de femmes
à manifester identique à celle que nous avons observée dans les cortèges des
24 novembre et 1er décembre. Un écart comparable
(55 % d’hommes, 44 % de femmes parmi les répondants) était observé
dans le questionnaire administré dans la Manif pour tous du 16 octobre
2016.
Les femmes ont toujours manifesté, comme le montrent de
nombreux travaux historiques. Elles sont en revanche ici plus visibles. A cela
plusieurs raisons : sans porte-parole officiel, représentants syndicaux et
politiques, qui sont habituellement des hommes, et en absence de structures,
les médias sont contraints de tourner le regard vers les participantes et
participants « ordinaires ». La forte dimension sociale du conflit et
la centralité des revendications sur les conditions matérielles d’existence
dans le mouvement social participent à la visibilité des femmes.
- Une surreprésentation des
bacheliers et des titulaires de CAP et BEP
Quelque 20 % des personnes interrogées sont diplômées
du supérieur (contre 27 % de la population générale, données
Insee 2014) ; 5 % des participants ont un bac + 4 et au-delà,
tandis que les deux niveaux de diplôme les plus représentés sont les détenteurs
de BEP et CAP, qui sont 35 % (contre 24 % dans la population
générale), et les bacheliers (29,3 % des répondants, contre 16,5 % de
la population générale). Seuls 15,4 % des participants ont un diplôme
inférieur au brevet (31,4 % de la population générale). Toutefois, le
8 décembre, nous avons reçu davantage de réponses de la part de personnes
ayant un diplôme de master ou équivalent. Se dessine ainsi une population de
participants ayant des niveaux de qualification intermédiaires.
- Des mobilisés aux revenus modestes
Quelque 55 % des répondants nous déclarent être
imposables (une proportion presque identique à la population générale) et
85 % indiquent posséder une voiture. Le revenu médian du foyer déclaré
représente 1 700 euros par mois, soit environ 30 % de moins que
le revenu médian moyen déclaré de l’ensemble des ménages (enquête
« Revenus fiscaux et sociaux » 2015 de l’Insee). Les
participants aux actions des « gilets jaunes » sont donc pour la
majorité d’entre eux des individus aux revenus modestes. Ils n’appartiennent
pas aux catégories les plus précarisées économiquement : 10 % d’entre
eux déclarent avoir un revenu inférieur à 800 euros par mois (contre
519 euros pour les 10 % des ménages français les plus pauvres).
- Des primo-manifestants en nombre
et des modes d’action variés
Pour presque la moitié des répondants (47 %), le
mouvement des « gilets jaunes » constitue leur première mobilisation.
Seuls 44 % ont déjà participé à une grève. Il s’agit donc de participants
peu rompus à l’action collective. Aux questions posées sur les formes d’action
collective que la personne serait prête à accomplir ou à laquelle elle a déjà
participé, la manifestation est le mode d’action le plus plébiscité
(81 %), suivi par la pétition (69,4 % d’entre eux déclarent en avoir
déjà signé une). Presque 9 participants sur 10 rejettent les modes
d’action impliquant des violences aux biens, mais 58,8 % d’entre eux se
déclarent par exemple prêts à occuper un bâtiment administratif. La moitié
exclut également l’idée d’aller manifester à Paris, les répondants évoquant des
raisons économiques, la violence et la nécessité de rester visible en province
pour justifier ce choix. Sur le consentement à l’impôt, seuls 5 % des
participants déclarent avoir déjà refusé de payer l’impôt, tandis que
58,4 % l’excluent complètement comme moyen d’action. Des analyses séparées
ont d’ailleurs relevé très peu de différences entre les réponses des hommes et
des femmes.
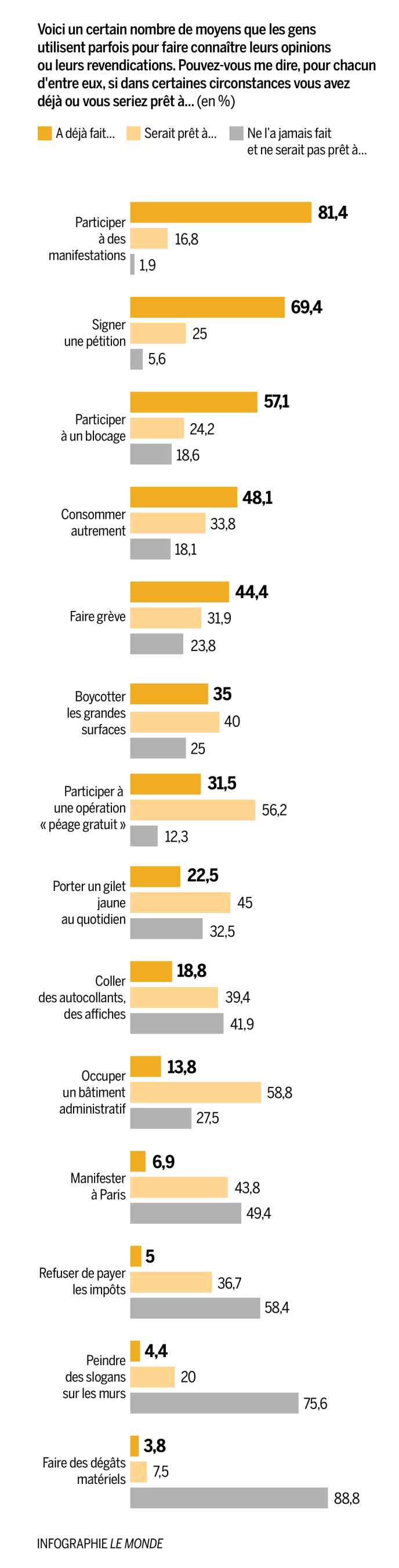
- Un rejet des organisations
représentatives traditionnelles et des orientations politiques atypiques
Notre enquête confirme également le large rejet des
organisations représentatives traditionnelles : 64 % considèrent que
les syndicats n’ont pas leur place dans le mouvement, 81 % pensent de même
pour tous les partis politiques.
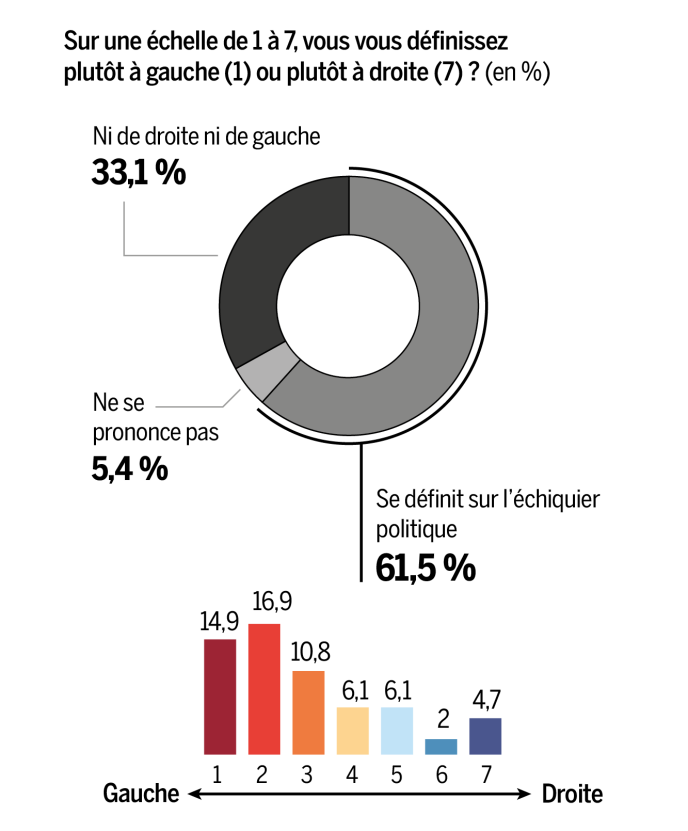 Infographie
Le Monde
Infographie
Le Monde
Ce rapport de distance ou de méfiance à l’égard du système
de représentation institué se retrouve lorsque les répondants sont invités à se
situer sur l’échelle gauche-droite. La réponse dominante consiste à se déclarer
comme apolitique, ou « ni de droite ni de gauche » (33 %). En
revanche, parmi ceux qui se positionnent, 15 % se situent à l’extrême
gauche, contre 5,4 % à l’extrême droite ; 42,6 % se situent à
gauche, 12,7 % à droite et, surtout, seulement 6 % au centre. En
comparaison, un
sondage conduit par Ipsos en avril montrait que 22 %
des Français rejettent le clivage gauche-droite, quand 32 % se situent à
gauche et 39 % à droite. Cette grande diversité du rapport au politique
est un élément majeur de la singularité du mouvement.
- Les motivations : pour le
pouvoir d’achat et contre une politique favorable aux riches
Pour les répondants, il s’agit moins d’une révolte contre
une taxe en particulier, ou pour la défense de l’usage de la voiture, qu’une
révolte contre un système fiscal et de redistribution jugé inique. Une révolte
contre les inégalités, mais aussi contre une parole politique qui les méprise
et les infériorise symboliquement. Il s’agit à la fois de défendre leur pouvoir
d’achat et leur accès à un standard de vie (notamment les loisirs, de plus en
plus inaccessibles) et d’une exigence de respect à leur égard et de
reconnaissance de leur dignité de la part du personnel politique (gouvernement
et président de la République).
Facebook, réservoir et carburant de la révolte des « gilets
jaunes »
L’usage du réseau
social par les contestataires peut expliquer l’essor du mouvement et, en partie,
sa radicalisation, estime dans son analyse Michaël Szadkowski, journaliste
au « Monde ».
« Donner au peuple le pouvoir de construire des
communautés » : tel était l’objectif affiché par le
fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, il y a un an, quand il a présenté sa
nouvelle vision pour le réseau social aux 2,2 milliards
d’utilisateurs actifs dans le monde, dont 38 millions en France. La
plate-forme venait d’essuyer une
volée de bois vert – à la suite de l’élection de Donald Trump
aux Etats-Unis –, pour avoir été un lieu privilégié de propagation de
fausses informations et d’influence étrangère, en l’occurrence russe, durant la
campagne présidentielle américaine.
Pour sortir de cette ornière, Facebook s’est lancé dans une refondation, en
misant davantage sur une de ses fonctionnalités : les groupes. Ce sont des
espaces, publics ou privés, au sein desquels les utilisateurs peuvent, sans
forcément être préalablement « amis », se connecter et discuter. Ils
étaient, pour
Mark Zuckerberg, une alternative aux « pages » diffusant
des informations – au premier rang desquelles celles des médias – et parfois
des infox, des informations fallacieuses.
Début
2018, Facebook a changé les règles d’affichage des publications,
privilégiant les contenus partagés par les amis, les sources d’informations
locales et les groupes.
Une galaxie de groupes « gilets jaunes »
Un an et demi plus tard, le mouvement des « gilets jaunes »
apparaît comme une illustration, d’ampleur inattendue, du choix de mettre en
avant ces groupes.
Car les protestataires utilisent abondamment cet outil pour se connecter,
organiser leur mobilisation et débattre, dans une volonté de construire « le
monde qu’ils veulent », comme le formulait Mark Zuckerberg.
Le contraste avec les organisations politiques est net. Lors de la dernière
campagne présidentielle, le mouvement En marche ! d’Emmanuel Macron avait
investi la messagerie chiffrée Telegram et La France insoumise avait choisi de
s’appuyer sur Discord, deux outils sécurisés et confidentiels,
apanages de petits groupes. A l’inverse, les « gilets jaunes » se
sont retrouvés sur un réseau social populaire, déjà ancien, lisible par tous,
où chacun, ou presque, disposait déjà d’un compte, avant d’aller bloquer un
rond-point.
Ce n’est pas la première fois, en France, qu’un mouvement de masse germe sur
Facebook : en 2013, par exemple, le
« soutien au bijoutier de Nice » avait rassemblé des millions de
personnes. Mais, organisé autour d’une page unique, il n’avait rien
à voir avec la floraison récente de groupes.
En quelques semaines, dans chacune de ces communautés, souvent nommées à
partir d’une ville ou d’un département, se sont réunies des dizaines, des
centaines ou des milliers de personnes. Si les groupes n’empêchent pas des
discussions plus privées dans d’autres applications (par
exemple sur WhatsApp), ils servent chaque jour, parfois chaque heure
ou minute, à diffuser des vidéos, des photos ou des commentaires politiques,
mais aussi des messages d’encouragements, de colère ou d’humour.
Parmi les choses vues après « l’acte III » du mouvement le 1er décembre,
on a ainsi recensé : une vidéo de « gilets
jaunes » dansant et insultant Macron au Vélodrome à
Marseille ; des portfolios
de photos du rond-point bloqué près de Gramat (Lot) ; le
chanteur Pierre
Perret entouré de manifestants ; un aperçu des
huîtres dégustées sur un barrage à Loudun (Vienne) ; un compteur
de « like » pour savoir si Macron doit rester ou non président ;
un chauffeur
routier qui conseille de « bloquer l’import-export mondial »
dans les ports ; un partage de la liste
des revendications ; un clip
de rap en selfie ; jusqu’à
un chien en gilet jaune réclamant des croquettes de qualité.
De nouvelles bulles de filtre
Mais au-delà de cet inventaire, il est pratiquement impossible de mesurer le
poids réel et le nombre total de publications générées par le mouvement.
Contacté, Facebook France indique ne pas avoir de chiffres précis liés à
l’utilisation de sa plate-forme par les « gilets jaunes » : les
données manquent pour déterminer s’il s’agit, concrètement, du plus gros
mouvement politique français ayant existé sur le réseau social jusqu’ici.
Autre zone d’ombre : avec les groupes, le phénomène de bulle de filtre,
qui conforte l’utilisateur d’un réseau social dans un ensemble de publications
avec lesquelles il est en accord idéologique, fonctionne à plein régime. Dans
les groupes des « gilets jaunes », tout le monde est d’accord, ou
presque, sur le fond, même si le débat est vivace autour des revendications et
des moyens d’action.
Lire sur le sujet : « Gilets
jaunes » : un cas d’école de la polarisation du débat public
Ainsi, les informations mensongères, contre lesquelles Facebook a
fini par consacrer de nombreux efforts pour en limiter la portée, ne
trouvent pas forcément de contradicteurs ou de mises en perspective au sein des
groupes de « gilets jaunes », dans lesquels se relaient des prises de
parole de citoyens (notamment avec des vidéos en direct) et des messages qui
commentent parfois des rumeurs complètement infondées.
Voir : « Gilets
jaunes » : le vrai et le faux du 17 novembre sur les réseaux
sociaux Lire
sur le sujet : « Constitution
disparue » et complotisme débridé sur les réseaux sociaux
Facebook compte d’habitude, pour cela, sur le signalement de publications
par d’autres utilisateurs, avant de les faire examiner par ses
équipes de dizaines de milliers de modérateurs. Un processus qu’un
groupe Facebook ne favorise pas : il n’est pas rare de voir des
publications flirtant avec les limites des « standards de la
communauté » du réseau social, qui interdisent, normalement,
les incitations à la violence.
Réactions timides
Face à ces défis, la réaction de Facebook reste timide. Contacté, le réseau
affirmait, jeudi 6 décembre, avoir renforcé ses équipes de modération et
de gestion de contenus problématiques. Une campagne classique de
sensibilisation aux fausses informations est également prévue. Mais cela semble
assez loin des enjeux révélés par cette crise. Une fois de plus, le réseau
social se trouve face à ses responsabilités.
Du côté des élus, la difficulté n’est pas moindre. Comment se reconnecter
avec ces lieux de débat qui ont essaimé loin d’eux ? L’épisode des
représentants des « gilets jaunes » qui ont tenté de rapatrier sur
Facebook leurs rencontres avec des ministres en
les filmant avec des Facebook Live, sans parler des menaces reçues
par le député (La République en marche) de l’Isère Olivier Véran, a montré
l’ampleur du fossé qui s’était creusé par le jeu des groupes.
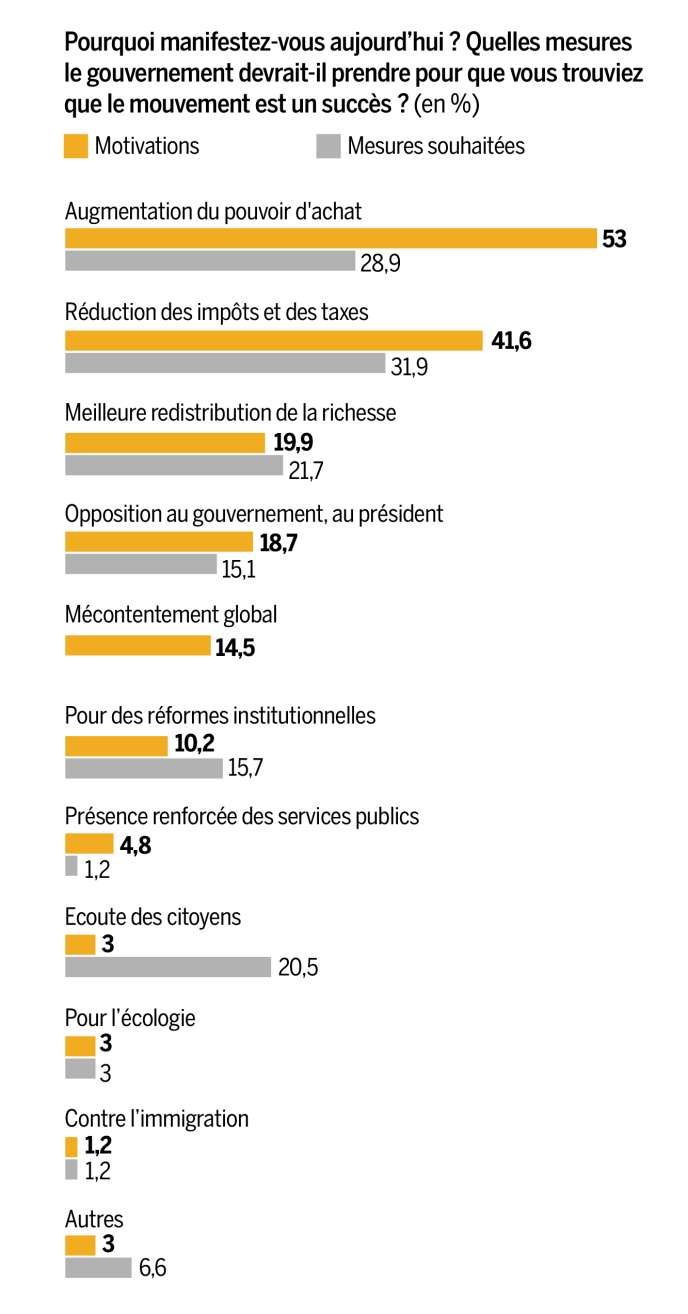 Infographie
Le Monde
Infographie
Le Monde
Nous avons invité les participants à s’exprimer sur leurs
motivations à travers une question ouverte en début du questionnaire
(« Pourquoi manifestez-vous aujourd’hui ? »). Un pouvoir d’achat
trop faible est le premier motif évoqué (plus de la moitié des répondants).
Plusieurs personnes se plaignent de ne plus pouvoir s’offrir le moindre plaisir
(« J’ai la vingtaine et j’ai pas une thune. Si je veux sortir, je dois
me mettre à découvert »). Des mères de famille nous font part de leurs
fins de mois difficiles (« J’aimerais bien que mes enfants puissent
avoir à manger dans leurs assiettes, et pas que des patates les deux dernières
semaines du mois »), qui entraînent parfois des difficultés de
logement, dont ont témoigné aussi bien des jeunes étudiants (« Je n’ai
pas les moyens de me loger, je vis dans la dépendance d’une amie »)
que cette mère de famille (« Nous étions obligés de descendre dans le
Sud pour vivre chez ma belle-mère »).
Suit, dans la liste des motivations, le fardeau fiscal trop
important (69 répondants, dont 18 qui pointent explicitement le prix élevé
du carburant). Près d’un sur cinq déclare être là pour protester contre le
gouvernement actuel et demande la démission d’Emmanuel Macron, évoquant l’« arrogance »
de l’exécutif. Les termes de « monarchie », d’« oligarchie »
ou de « dictature » reviennent pour souligner son caractère
illégitime. On voit poindre le 24 novembre, puis se confirmer le 1er décembre,
la demande de réformes institutionnelles. Un dixième des enquêtés demandent des
réformes institutionnelles. Cette tendance semble accentuée chez les
participantes et participants aux cortèges du 8 décembre.
Une deuxième question ouverte portait sur les mesures que le
gouvernement devrait prendre pour répondre aux revendications des « gilets
jaunes ». La réponse la plus fréquente est sans surprise une baisse des
taxes et impôts, évoquée spontanément par un tiers des répondants. Pour
48 enquêtés, des mesures pour augmenter le pouvoir d’achat sont également
nécessaires. Parmi eux, 28 personnes demandent une augmentation du smic,
voire des salaires en général, 14 une augmentation générale du pouvoir d’achat,
8 une augmentation des retraites. Des demandes de reditsribution des richesses
reviennent dans les réponses de 36 participants : 19 demandent
spontanément la réintroduction de l’ISF, 5 une répartition plus juste des
impôts.
« Une des spécificités de ce mouvement est la présence
de revendications institutionnelles, en plus des revendications sociales »
Plus d’un cinquième des répondants demandent d’ailleurs tout
simplement que le gouvernement écoute les citoyens, « qu’il se mette à [leur]
place ». Il s’agit ainsi d’une des préoccupations principales des
personnes rencontrées. Enfin, une des spécificités de ce mouvement est la
présence de revendications institutionnelles, en plus des revendications
sociales. Ainsi, 26 personnes ont déclaré que des réformes institutionnelles
importantes seront nécessaires pour qu’elles puissent considérer que le
mouvement est un succès : 18 en demandant des changements parfois
fondamentaux (par exemple, en réclamant une « réforme totale de
l’Etat », « un autre système politique »), 8 en
demandant la fin des privilèges des parlementaires et 4 en se disant convaincus
de la nécessité d’une VIe République.
Il est à noter que seulement 2 des 166 personnes
interrogées ont mentionné la gestion de l’immigration dans leurs réponses aux
deux questions présentées. Cela invite à reconsidérer les analyses qui font du
mouvement une émanation de l’extrême droite.
« Les deux principales motivations des personnes
mobilisées apparaissent comme étant une plus grande justice sociale et la
demande d’écoute de la part du pouvoir »
Les deux principales motivations des personnes mobilisées
apparaissent donc comme étant une plus grande justice sociale (qu’il s’agisse
d’un système fiscal faisant davantage participer les plus aisés, d’une
meilleure redistribution des richesses ou encore du maintien des services
publics) et la demande d’écoute de la part du pouvoir. Au contraire, les
revendications nationalistes, liées notamment à l’identité ou à l’immigration,
sont très marginales, démentant l’idée d’un mouvement qui serait noyauté par
les électeurs ou les militants du Rassemblement national. Comme le souligne le
sociologue Alexis Spire, auteur de Résistances à l’impôt, attachement à
l’Etat (Seuil, 312 pages, 22 euros), c’est avant tout le
sentiment d’injustice fiscale, plus prégnant chez les classes populaires, qui
explique cette mobilisation.
En résumé, cette révolte est bien celle du
« peuple » – comme se revendiquent nombre de personnes interrogées –
au sens des classes populaires et des « petites » classes moyennes,
celle des revenus modestes. Dès lors, plusieurs éléments font des « gilets
jaunes » une contestation singulière par rapport aux mouvements sociaux
des dernières décennies. Outre son ampleur, la forte présence des employés, des
personnes peu diplômées, des primo-manifestants et, surtout, la diversité des
rapports au politique et des préférences partisanes déclarées font des
ronds-points et des péages des lieux de rencontre d’une France peu habituée à
prendre les places publiques et la parole, mais aussi des lieux d’échange et de
construction de collectifs aux formes rarement vues dans les mobilisations.
Camille Bedock,
Centre Emile-Durkheim, Sciences Po Bordeaux, CNRS
Antoine Bernard de Raymond, Irisso, université Paris-Dauphine, INRA
Magali Della Sudda, Centre Emile-Durkheim, Sciences Po Bordeaux, CNRS
Théo Grémion, diplômé d’un master de géopolitique de l’université de
Genève et d’une maîtrise d’urbanisme de l’université Paris-X
Emmanuelle Reungoat, Centre d’études politiques de l’Europe latine,
université de Montpellier
Tinette Schnatterer, centre Emile-Durkheim, Sciences Po Bordeaux, CNRS
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire